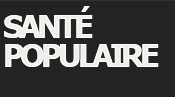Aperçu du cycle normal de sommeil
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
Aperçu du cycle normal de sommeil
Le sommeil est indispensable comme la lumière, la nourriture et l'eau, mais son rôle demeure néanmoins incompris. Il s'agit d'un état composé de divers processus complexes orchestrés par différents systèmes cérébraux. Les théories adaptatives laissent entendre que le sommeil sert de mécanisme de défense pour garder l'organisme hors de danger durant ses périodes d'inactivité. Les théories récupératrices mettent toutefois de l'avant que le sommeil a un rôle de « maintenance » par l'entremise duquel les tissus organiques et les fonctions psychiques sont restaurées. Le sommeil serait également responsable de nombreux aspects de la conservation de l'énergie, de la régulation de la température corporelle et de l'immunité.
Le sommeil, tout comme beaucoup d'autres fonctions biologiques (température corporelle, sécrétion d'hormones de croissance) et comportementales (manger, travailler), est régulé par des rythmes circadiens. Des horloges biologiques internes situées dans l'hypothalamus gèrent l'alternance entre les différents états en interagissant étroitement avec des indices externes de temps perçus dans l'environnement, également appelés des zeitgebers [synchroniseurs]. Pour les fonctions du sommeil, le plus important de ces indices environnementaux est le cycle lumière-obscurité (nycthémère), mais il y a aussi d'autres indices externes, comme les interactions sociales, les horaires de travail et les heures de repas. Les variations quotidiennes dans la température centrale du corps, également contrôlées par les facteurs circadiens, sont étroitement liées aux schémas veille-sommeil. À leur plus bas niveau aux premières heures du jour (de 3 h à 5 h du matin), la température corporelle commence à augmenter peu avant le réveil et atteint son apogée en soirée. La vigilance est à son maximum dans la pente ascendante de la courbe de température corporelle. En revanche, la somnolence et le sommeil se produisent lorsque la température baisse. En l'absence d'indices de temps et de toute contrainte, les individus ont tendance à choisir le moment de se coucher qui est le plus étroitement lié à une baisse de la température corporelle, alors que le réveil survient peu de temps après qu'elle ait recommencé à augmenter. Des facteurs de nature homéostatique sont également en jeu dans le processus du sommeil. Par exemple, le temps requis pour s'endormir est inversement proportionnel à la durée de la période de veille précédente. Lorsqu'une période de privation de sommeil prolongée survient, une propension au sommeil de plus en plus forte se fait sentir. Dès que le manque de sommeil est récupéré, un effet rebond produit une latence d'endormissement plus courte, une durée totale de sommeil accrue et une plus grande portion de sommeil profond.
Au moyen d'une technique appelée la polysomnographie, combinant la mesure de l'activité cérébrale, des mouvements oculaires et du tonus musculaire, on distingue deux types de sommeil: le sommeil lent (ou NREM pour non-rapid-eye-movement) et le sommeil paradoxal (ou REM pour rapid-eye-movement). Différents schémas d'activité cérébrale détectés au cours du sommeil NREM sont subdivisés en quatre stades distincts: les stades 1, 2, 3 et 4. En état de somnolence au départ, l'individu passe d'abord par le stade 1, un sommeil léger, puis évolue de façon séquentielle tout au long des stades de sommeil plus profond (les stades 2, 3 et 4 du sommeil NREM). Le stade 1, d'une courte durée (environ 5 minutes), est un stade de transition entre l'état de veille et le sommeil plus défini. Le stade 2 dure généralement de 10 à 15 minutes. Pour la plupart des gens, le stade 2 correspond à l'expérience du phénomène de s'endormir. Les stades 3 et 4 sont considérés comme étant les stades les plus profonds du sommeil et ensemble ils durent entre 20 et 40 minutes dans le premier cycle du sommeil. On les désigne souvent comme étant les phases « delta » du sommeil ou « sommeil à ondes courtes » en raison de la présence d'ondes lentes de forte amplitude appelées les ondes delta. Après avoir atteint le stade 4, le schéma électroencéphalographique revient vers le stade 3, le stade 2, et laisse finalement place au premier épisode de sommeil REM. Ces cycles de sommeil NREM et REM se répètent de quatre à 5 fois au cours de la nuit selon une séquence structurée et une prédominance du sommeil à ondes courtes dans le premier tiers de la nuit, alors que la période de sommeil REM est prédominante dans la dernière partie de la nuit ou aux petites heures du matin. Les adultes présentant des schémas de sommeil normaux passent approximativement 25 % de leur durée de sommeil en sommeil REM et 75 % en sommeil NREM. Le stade 1 du sommeil NREM représente environ 5 %, le stade 2 environ de 45 à 60 %, les stades 3 et 4 entre 5 et 20 % et le sommeil REM représente de 15 à 35 % de la durée totale du sommeil.
Au cours du sommeil REM, l'activité cérébrale s'apparente beaucoup à celle que l'on observe au stade 1. Cependant, à la différence du stade 1 de sommeil initial, les yeux bougent rapidement sous les paupières et il y a une perte simultanée du tonus musculaire central dans le reste du corps. Ce stade est parfois appelé « sommeil paradoxal » parce que le corps est essentiellement paralysé, malgré les spasmes musculaires occasionnels, mais l'activité dans le cerveau et le système autonome sont de niveaux équivalent à celui que l'on observe durant l'état de veille. Il s'agit également du stade où la plupart des rêves lucides se produisent. Des études sur la privation de sommeil laissent entendre que le sommeil NREM, en particulier les stades 3 et 4, est important pour la restauration de l'énergie physique, alors que le sommeil REM aurait un rôle à jouer dans la consolidation des connaissances nouvellement acquises et dans le traitement de l'information sensorielle.