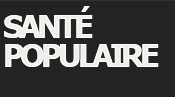L’écologie en question
Environnement
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
Bonne nouvelle ! La planète n’est pas en danger. Du moins pas autant qu’on pourrait le redouter. Et la plupart des prétendues menaces écologiques dont les médias brandissent quotidiennement le spectre sont largement exagérées. C’est en tout cas la thèse d’un jeune statisticien danois, Bjorn Lomborg, dont le livre est enfin publié en France en ce début d’année 2004. Un ouvrage déjà plusieurs fois traduit dans le monde, qui arrive chez nous précédé d’une forte odeur de soufre, tant les polémiques suscitées par ses idées iconoclastes ont été vives dans les milieux scientifiques et écologistes.
Le trou dans la couche d’ozone ? Le réchauffement de la planète ? Les OGM ? L’extinction des espèces ? Celle des forêts ? Des défis réels mais dont l’importance est trop souvent amplifiée et sert une « litanie » de mythes pessimistes éloignés de la réalité, selon Lomborg, qui affirme avoir eu une révélation après avoir étudié longuement l’ensemble des statistiques disponibles sur l’évolution de la situation environnementale. « Le monde va dans la bonne direction. Aucune catastrophe écologique ne nous attend au coin de la rue pour nous punir », annonce ainsi Lomborg, qui assure être lui-même surpris par ses propres découvertes. Une analyse que conteste fortement Noël Mamère. Le député-maire vert de Bègles dénonce ainsi avec véhémence la méthode autant que les arguments de Lomborg et soutient que les défis éco-logiques doivent plus que jamais rester aux premiers rangs de nos préoccupations, associant notamment le combat pour l’environnement à celui contre l’exploitation du tiers-monde.
Désormais, pas une semaine ne se passe sans qu’un article ou un reportage ne vienne nous rappeler que la Terre est un organisme fragile à l’équilibre précaire. Notre époque nous incite à devenir chaque jour plus attentif et sensible à la cause écologiste. Laquelle ne se limite plus à la seule protection de la nature, mais englobe, comme le montre clairement ce débat, l’ensemble de la problématique sur le développement. Alors, le monde va-t-il de plus en plus mal ou « plutôt mieux qu’avant » ? Doit-on changer l’ordre des priorités ou bien maintenir une vigilance exacerbée face à un avenir toujours menaçant ? Réponses contrastées du chercheur danois et de l’écologiste français.
Bjorn Lomborg, vous affirmez dans votre livre que les chiffres disponibles sur l’état de notre planète sont beaucoup moins catastrophiques qu’il n’y paraît. Mais alors, comment expliquer, par exemple, que les habitants de Paris, de Milan ou d’Athènes ont l’impression de respirer de plus en plus mal ? Les statistiques observées peuvent-elles les convaincre qu’ils se trompent ?
Bjorn Lomborg Bien sûr, les statistiques ne sont pas une fin en soi, mais c’est le seul moyen de comprendre clairement quel est l’état de notre planète et de nos sociétés. Si nous devons parler de l’état du monde de manière scientifique, nous devons nous appuyer sur les statistiques disponibles et non sur nos intuitions. Prenons l’exemple de la pollution justement. Si vous étudiez les données actuellement disponibles, celles compilées par l’OCDE entre autres, vous verrez qu’à Paris la pollution de l’air a décliné de 53 % depuis 1980. De la même façon, la pollution a baissé de 42 % à Athènes depuis 1986 et de 61 % à Milan depuis 1980. L’impression de “moins bien respirer” dans ces villes est donc tout simplement une intuition trompeuse.
Prenons également le débat sur les pesticides qu’on présente à longueur de journée comme une cause majeure d’augmentation de cancers. En réalité, si nous buvons pendant toute une vie de l’eau dont la teneur en pesticides est équivalente au seuil limite préconisé par l’Union européenne, nous avons le même risque de mourir que si, pendant cette même vie, nous fumons 1,4 cigarette ou que nous buvons un demi-litre de vin par jour. En réalité, les pesticides causent très peu de morts, mais l’insistance des médias fait que beaucoup de gens pensent qu’ils sont plutôt dangereux.
De manière plus générale, nous devons nous habituer à l’idée que toutes les décisions que nous prenons se résument à un échange de risques : nous n’aurons jamais de certitude de sécurité absolue. Il faut donc arrêter de donner une dimension apocalyptique à notre vision de l’environnement. En vérité, les conditions de vie sur notre planète n’empirent pas. Nous avons plus de temps libre, plus de confort, une meilleure éducation, des vies plus saines et plus longues. Il reste des problèmes, mais l’environnement n’est qu’un des défis à relever pour un monde meilleur.
Noël Mamère Bjorn Lomborg n’étudie pas la réalité de cette planète et de ses inégalités puisqu’il la regarde à travers le filtre des statistiques auxquelles, chacun le sait, on peut faire dire ce qu’on veut ! De nombreuses études contredisent ainsi son opinion sur les pesticides : on a constaté de manière tout à fait scientifique des cas d’augmentation de la stérilité des femmes et une perte d’attention des enfants à l’école après les périodes d’épandage. Certes, depuis le XIXème siècle, les conditions de vie se sont améliorées sur une bonne partie de la planète. Mais c’est la moindre des choses au regard des progrès technologiques. Le vrai problème, c’est le maintien d’inégalités flagrantes. Et, aujourd’hui encore, les conditions de vie demeurent insupportables pour une bonne partie de l’humanité.
Puisque Lomborg parle de chiffres, citons celui-là : selon le Programme des Nations unies pour le développement, 75 % du continent africain vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qui représente la limite la plus basse du seuil de pauvreté. Bien plus de 40 % des Africains vivent avec moins de 1 dollar par jour. Pourquoi 1,8 milliard d’êtres humains n’ont-ils toujours pas accès à l’eau potable ? Pourquoi le fossé entre les vingt pays les plus riches et les vingt pays les plus pauvres a-t-il doublé durant les trente dernières années ? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre en priorité. Des questions qui interpellent nos modes de développement et de consommation, qui nous rappellent qu’on pille toujours les pays les plus pauvres, et je pense notamment aux forêts primaires et au brevetage des plantes qui appartiennent au patrimoine de l’humanité.
Ce sont ces formes honteuses de colonialisme qui conduisent également certains pays riches à soutenir dictatures et tyrans à travers le monde et ce, pour des intérêts uniquement économiques. Pourquoi la société Total, par exemple, s’obstine-t-elle à rester en Birmanie et à soutenir une junte qui emprisonne un prix Nobel de la Paix, fait travailler les enfants et vit du trafic de drogue ? Effectivement, on peut toujours trouver des exemples d’amélioration des conditions de vie, et il y en a. Mais ils ne suffisent pas à englober le problème général de notre planète.
Bjorn Lomborg Je me permettrais tout d’abord de rappeler que dénigrer ainsi l’utilisation de statistiques en affirmant « qu’on peut leur faire dire ce qu’on veut » équivaut à dénigrer la science elle-même. Est-ce que Noël Mamère a le même regard désabusé sur les statistiques quand elles confortent ses propres arguments ? J’enseigne les statistiques à l’université et je sais qu’ elles peuvent être parfois interprétées de façon biaisée, mais encore une fois elles demeurent le fondement le plus scientifique de notre compréhension du monde. Pour analyser la réalité, on ne peut pas se contenter des médias qui ne font état que des événements et le plus souvent se concentrent sur les mauvaises nouvelles.
Par ailleurs, je suis évidemment conscient qu’il reste beaucoup de problèmes à régler sur notre planète. Il y a encore beaucoup trop de pauvreté dans le monde, encore trop de famine, et le nombre de gens privés d’ eau potable reste scandaleusement élevé. Toutefois, même si ces problèmes restent cruciaux et nécessitent des réponses urgentes, cela n’empêche pas une constante et nette amélioration de l’état du monde. Dans les années 50, la moitié du monde en développement était considérée comme pauvre. Aujourd’hui, ce même montant est de “ seulement “ 24 %. Bien sûr, c’est encore trop. Reste que nous avançons dans la bonne direction. On peut également évoquer la famine : dans les années 50, 45 % du monde en développement mourait de faim. Aujourd’hui, la famine ne touche “ que “ 18 % de cette population. Et, en 2030, l’ONU espère voir cette proportion tomber à 6 %. Il faut arrêter de nier l’évidence : la situation alimentaire s’est considérablement améliorée dans le monde. Ce qui ne doit pas nous empêcher de nous préoccuper de tous ceux qui continueront de mourir de faim. Nous le ferons d’ autant mieux que nous aurons pris conscience que nous sommes dans la bonne voie, même si ce n’est peut-être pas à un rythme satisfaisant et même si nous devons sûrement faire plus pour améliorer les choses. Noël Mamère remet en cause nos modes de développement et de consommation. Le problème n’est pas d’abaisser nos propres conditions de vie, mais d’améliorer celles du tiers-monde en leur permettant d’écouler leurs produits sur nos marchés, et d’avoir accès aux techniques agricoles les plus modernes, y compris les pesticides et les OGM.
Noël Mamère Mais comment peut-on affirmer que nous allons dans la bonne direction ? Ce qui tue l’agriculture du tiers-monde, ce sont les subventions agricoles que les pays riches accordent à leurs propres agriculteurs. Je ne dis pas que nous devons abaisser le niveau de vie de l’occident, mais simplement que nous devons freiner le gaspillage à outrance. Bjorn Lomborg sait bien que les pays riches serventde modèles aux pays pauvres.
Bjorn Lomborg Les problèmes du tiers-monde sont plus liés au développement qu’à l’environ- nement. Noël Mamère fait fausse route quand il évoque la cupidité occidentale ou le désin- térêt pour l’environnement. Les problèmes de l’Afrique, par exemple, tiennent avant tout à de mauvaises politiques locales.
Comme l’a reconnu l’ONU dans une déclaration pour une fois très franche, « Ce ne sont pas les ressources ni les solutions économiques qui manquent en Afrique, mais la volonté politique de combattre la pauvreté ». L’ONU constate également que l’amélio-ration de la situation alimentaire sur ce continent dé-pend avant tout de l’obligation faite aux gouverne-ments locaux de garantir et protéger les droits écono-miques, sociaux et politiques des plus pauvres. Pour combattre la pauvreté, il faut en priorité garantir le droit à la propriété, le libre accès aux capitaux, une politique de santé efficace et une meilleure éducation.
Noël Mamère Bien sûr, le tiers-monde dispose de ressources. Mais on ne doit pas oublier que des institutions comme le FMI et 1a Banque mondiale, ainsi que certains pays riches, ont contribué à la dégradation de la situation en favorisant les régimes dictatoriaux et en participant au pillage des ressources naturelles. Et que dire du rôle d’Elf au Congo-Brazzaville ou du groupe Bolloré au Gabon, qui participé à la destruction des forêts primaires ? Aujourd’hui, on ne peut plus séparer le développement de l’environnement.
Vous avez tous les deux des opinions différentes sur les priorités des politiques menées pour préserver l’environnement. Deux sujets sensibles peuvent refléter cette opposition : le protocole de Kyoto et les OGM...
Bjorn Lomborg Je ne sous-estime pas le rôle des poli-tiques environnementales, simplement je constate que nos ressources ne sont pas illimitées et que nous de-vons donc faire des choix...
En ce qui concerne le protocole de Kyoto, ce n’est clairement pas une solution. Évidemment, il est devenu aujourd’hui très politiquement correct d’être proKyoto. Pourtant, cet accord nous conduirait à dépenser beaucoup d’argent pour un résultat très mince : en signant ce protocole, les pays industrialisés acceptent de faire baisser leurs émissions de dioxyde de carbone de 30 % jusqu’à l’an 2010. Cela nous coûtera selon les estimations entre 150 et 350 milliards de dollars par an. Pourtant, les effets sur le réchauffement planétaire seront très modestes puisque Kyoto ne fera que retarder de six ans l’augmentation de la température terrestre. Bref, en 2016, nous nous retrouverons face à la même situation que nous avons cherché à éviter en 2010.
La majeure partie des problèmes liés au réchauffement planétaire aura de toute façon lieu dans le tiers-monde. Alors, si nous sommes prêts à dépenser 150 millions de dollars par an, pourquoi ne pas les consacrer à des problèmes plus urgents, comme l’accès à l’eau potable justement ? Encore une fois, il s’agit de parler un langage de vérité et de dire à nos démocraties qu’il y a de meilleurs moyens d’aider le tiers-monde que de s’obstiner sur le protocole de Kyoto qui apportera très peu d’améliorations à un coût pourtant très élevé. L’enjeu est toujours le même : ne pas gonfler artificiellement les problèmes écologiques et minimiser ainsi d’autres problèmes plus urgents, mais évidemment moins sensationnels.
En ce qui concerne les OGM, je ne dis pas que nous ne devons, pas prendre des précautions et, d’ailleurs, nous en prenons tellement actuellement que ce sont les techniques agricoles les plus surveillées au monde ! Mais je souligne aussi que cette prudence à un coût et qu’on doit le comparer aux bénéfices possibles, notamment dans le tiers-monde, où les OGM apporteraient une meilleure résistance des plantes aux insectes et à la sécheresse, augmentant également les rendements de production.
Noël Mamère Kyoto a le mérite d’exister. Nous ne pouvons pas nous contenter du laisser-faire, il faut édicter des règles, se fixer des objectifs. D’ailleurs, le chemin est loin d’être achevé puisque tous les pays n’ ont pas encore signé l’accord de Kyoto. Quant aux OGM, ils ne sont pas une solution pour les pays pauvres. C’est la réforme de l’aide au développement qui aidera l’agriculture des pays du tiers-monde. Aujourd’hui, nous commençons à réaliser l’ampleur des dégâts causés par l’industrie chimique. Mais avec les OGM, les risques pourraient être dix fois plus graves en raison de leur caractère irréversible et des dangers spécifiques pour l’espèce humaine. Ce n’est pas un progrès que d’autoriser les firmes transnationales à mener des cultures expérimentales pour leurs seuls besoins économiques sans avoir mesuré l’impact de cette artificialisation de la nature sur l’environnement et la santé publique. Cautionner l’idée qu’on pourrait minimiser les risques de la planète et de ceux qui l’habitent est complètement irresponsable. Monsieur Lomborg sait sans doute que les Américains sont en train de freiner des quatre fers sur les plantes génétiques “ médicales “ qui ont déjà pollué des centaines d’hectares de plantes conventionnelles.
En réalité, le succès de Bjorn Lomborg ne tient pas à la valeur de ses thèses, mais à son attitude systématique de contre-pied de la pensée courante des écologistes. Aujourd’hui, il s’en prend aux Verts et aux associations écologistes en les accusant de défendre simplement leurs membres et leurs intérêts. Pour la grande majorité, ces associations sont des contrepouvoirs dont le seul but est de pousser les responsables politiques à ne pas insulter l’avenir et donc à offrir à nos enfants autre chose qu’un monde en miettes.
Bjorn Lomborg Je prends volontiers pour acquis que les mouvements écologistes veulent le bien de la planète. Dans ce débat, tout le monde milite d’ailleurs pour le bien ! Je considère juste que les écologistes ne voient qu’un aspect des problèmes et que nous ne devrions pas les considérer comme les seuls détenteurs de la vérité. Les écologistes, et c’est leur rôle, mettent l’accent sur les problèmes environnementaux. Mais il y a d’autres enjeux cruciaux dans le monde. On peut noter par ailleurs que trop souvent ils s’empressent de nous avertir quand le taux de déforestation en Amazonie augmente, mais pas quand il baisse. Quand la Nasa a annoncé un trou dans la couche d’ozone au-dessus des États-Unis en 1992, l’événement a fait la une du magazine Times. Deux mois plus tard, quand la Nasa a démenti, l’information n’a eu droit qu’à quatre lignes dans ce même magazine. Notre société produit aujourd’hui beaucoup plus d’informations sur les risques. Mais nous avons parfois tendance à sous-estimer les risques importants et à surestimer les risques majeurs. Il faut rester vigilants sur les problèmes environnementaux, mais nous devons être prudents dans nos analyses, garder un esprit critique face aux arguments avancés pour en fin de compte cerner les vrais problèmes qui nous menacent.
Environnement |