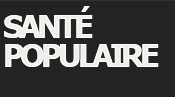Immuniser sans effet secondaire
Bioentreprise
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
300 millions de personnes atteintes dans le monde, dont près de la moitié dans l’hémisphère Nord où 15 à 25 % de la population est touchée. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elles se classent au quatrième rang des affections les plus fréquentes. Tel est le triste bilan des allergies. Celles aux venins, aux pollens et aux produits alimentaires (arachide, lactose, gluten...) affectent, à elles seules, plus de 60 millions des individus vivant au-dessus de l’équateur.
En contact avec un allergène, l’organisme allergique produit une quantité trop élevée d’immunoglobulines E (IgE) spécifiques de cet antigène lesquelles, en se fixant aux mastocytes, vont induire la libération d’histamine (un dérivé de l’histidine) par ces derniers. Libérée, la molécule stimule à son tour des récepteurs ubiquitaires qui déclenchent la vasodilatation des capillaires sanguins, rendant leur paroi perméable. S’ensuit une « hémo-concentration » de globules blancs, notamment de lymphocytes T, qui peuvent plus facilement pénétrer les tissus pour atteindre la zone en contact avec l’allergène à détruire. Cette réaction allergique, disproportionnée, de l’organisme se traduit par des rougeurs, des démangeaisons, des oedèmes et, dans les cas les plus graves, par une chute de la pression artérielle pouvant provoquer un arrêt cardiaque.
Traditionnellement, on connaît trois méthodes pour contrer les allergies : en éliminer les causes (régime spécifique, purificateur d’air, produits anti-acariens...), traiter les symptômes (essentiellement grâce à des antihistaminiques) et désensibiliser. Cette dernière méthode, également appelée « immunothérapie spécifique », s’attaque à la cause moléculaire de l’allergie selon le principe de mithridatisation : habituer petit à petit l’organisme à tolérer l’allergène. Efficace dans 80 % des cas, elle permet, au prix d’une démarche longue (3 à 5 ans) et de nombreux effets secondaires, de se débarrasser du problème. Du moins d’une allergie. Car celles-ci peuvent se combiner et nécessiter, de fait, autant de traitements de désensibilisation.
Créée en 2001 par son actuel président François Spertini, professeur au CHU de Lausanne, l’entreprise suisse Anergis propose une méthode innovante pour lutter contre les allergies. Anergis, dont le nom découle du terme immunologique « allergique » qui signifie « incapable de réagir », a en effet découvert un moyen d’empêcher les lymphocytes T de déclencher l’inflammation.
Tout commence en 1995. François Spertini travaille alors sur des injections de fragments d’allergènes, des COPs (Contiguous Overlapping Peptides), du venin d’abeille. Il s’agit de peptides de synthèse de 40 à 100 acides aminés reproduisant la séquence de l’allergène mais dépourvus de structure tridimensionnelle, clé de la reconnaissance de l’antigène par les IgE. Et sans liaison avec les IgE, pas de réaction allergique, même minime. La présentation de l’allergène sous cette forme induit, a contrario, une tolérance T, via la sécrétion d’interleukine 10 et de TGF-β, notamment, et la production d’IgG4 qui inhibent la liaison allergène-IgE lors d’une réexposition. C’est donc une reprogrammation du système lymphocytaire T que propose Anergis. Et les avantages semblent nombreux. Outre l’absence d’effet secondaire, principal écueil de la désensibilisation aux yeux des patients, le temps d’exposition tombe à deux mois au lieu de plusieurs années et la thérapeutique se veut ciblée en comparaison des préparations classiques composées, en plus de l’allergène, d’un ensemble de molécules susceptibles d’induire une sensibilisation non recherchée. Et, par-dessus tout, l’approche semble adaptable à tous les types d’allergies médiées par les IgE alors que la désensibilisation est par exemple inefficace contre l’allergène de l’arachide. Après quelques essais cliniques de phase 1 et le dépôt d’un brevet international, François
Spertini lance Anergis, qui s’attaque désormais à un autre fléau pour les allergiques : le pollen du bouleau. Un essai clinique de phase II a d’ailleurs débuté en août pour AllerT, premier produit de l’entreprise, afin de vérifier la tolérance des patients ainsi que la capacité du produit à anergiser la réponse T spécifique et à générer la production d’IgG4.
« À ce stade, Anergis est soutenue par des fonds privés, des actionnaires et une fondation à hauteur de 700 000 €. Nous cherchons à boucler un premier tour de table à hauteur de 10 M € pour une projection de développement à 5 ans, incluant les suites de notre projet « allergie au bouleau » ainsi qu’un gros effort de recherche, à la fois préclinique et clinique, orienté vers les allergies alimentaires », souligne François Spertini.
Bioentreprise |