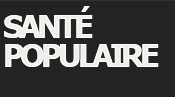Suppllémentation nutritionelle : le plus peut être l'ennemi du bien
Nutrition
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
Depuis quelques années, la notion erronée selon laquelle une alimentation équilibrée couvrirait difficilement les besoins nutritionnels des individus se développe dans la population, parallèlement à la communication croissante des industriels. Certes, des apports insuffisants en calcium, fer, vitamine D, iode, etc. ont été constatés dans certaines populations (adolescents, femmes enceintes, personnes âgées...). Le recours à la supplémentation nutritionnelle chez un individu ne devrait cependant être décidé qu’après analyse de la couverture de ses besoins et du bénéfice de cet apport.
Entre besoin réel et apport conseillé : la marge de sécurité
La supplémentation nutritionnelle d’une population nécessite une connaissance précise de la prévalence et de l’intensité de ses éventuels déficits nutritionnels et de leurs conséquences pour cette population. Pour un individu, l’absence de consommation des apports nutritionnels conseillés (ANC) pour un nutriment ne signifie pas pour autant qu’il soit en situation de déficit pour ce nutriment.
Les ANC, obtenus en ajoutant deux déviations standard au besoin nutritionnel moyen (BNM), c’est-à-dire à la moyenne de la consommation réelle d’une population, sont destinés à couvrir les besoins de la quasi-totalité (97,5 %) de cette population. Il existe donc une marge de sécurité. Avant d’envisager une supplémentation nutritionnelle, il faut, bien sûr, s’assurer qu’une alimentation équilibrée ne permet pas, ou difficilement, la correction des déficits nutritionnels.
Efficacité et innocuité : deux exigences indissociables
Il est indispensable de contrôler l’efficacité d’un complément alimentaire à corriger un déficit et de vérifier son innocuité. Pour les sujets indemnes du déficit et les populations les plus fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées...), les limites de sécurité en termes d’apport ne doivent être ni atteintes, ni a fortiori dépassées. Les compléments alimentaires devant répondre aux exigences réglementaires des denrées alimentaires, la sécurité sanitaire du consommateur doit bien évidemment être garantie.
Allégations : flirt avec la tromperie
Le code de la consommation stipule que les allégations qui ne peuvent être justifiées sont interdites afin de ne pas tromper le consommateur, qu’un lien de causalité doit être prouvé entre l’aliment et l’allégation proposée, et que l’information doit être cohérente pour le consommateur.
De nombreuses allégations concernant les supplémentations nutritionnelles ne sont pas soutenues par des données scientifiques solides mais, tout au plus, suggérées par la nature de la supplémentation, qui pourrait, en théorie, participer à un effet bénéfique. Elles constituent donc en ce sens une tromperie du consommateur.
Un des exemples les plus caricaturaux est celui concernant les oméga 3. Une amélioration des performances neuro-comportementales après supplémentation en oméga 3 à longue chaîne a été rapportée dans la littérature internationale, mais uniquement chez des enfants atteints d’une pathologie très spécifique (hyperactivité et déficit de l’attention) et pas dans l’ensemble de la population pédiatrique, qui constitue la cible affichée de certaines firmes commercialisant des compléments alimentaires riches en oméga 3.
Sans optimisme excessif, la réglementation européenne sur les allégations nutritionnelles et de santé, qui prendra effet au 1er juillet 2007, et la mise en place progressive des profils nutritionnels devraient mettre un peu d’ordre dans une situation, qui n’est pas actuellement satisfaisante.
Un fabricant ne devrait pas commercialiser un produit innovant sans que des données soient fournies, justifiant au minimum de l’absence d’effets délétères pour les consommateurs. Malheureusement, à l’exception des nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires (règlement CE N° 258/97 du 27 janvier 1997), il ne revient plus au fabricant de prouver l’innocuité de son produit, mais aux autorités réglementaires de démontrer les risques liés à sa consommation. Les règles du jeu ont changé, au détriment de la sécurité et du respect du consommateur.
Nutrition |