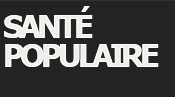Virus entériques Une préoccupation émergente
Santé publique
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
La virologie est, sans conteste, le parent pauvre de la recherche en microbiologie alimentaire. Très peu enseignée, cette discipline s’adresse, pour l’essentiel, au domaine médical. Pourtant, le mode de transmission fécoorale des virus entériques implique aussi l’alimentation, même si l’eau et les contacts interhumains en sont les principaux vecteurs. Les problèmes intestinaux que nous connaissons tous un jour ou l’autre ne sont pas à négliger. Les toxi-infections alimentaires d’origine virale n’engendrent, pour la plupart des cas, que des troubles mineurs (diarrhée), mais certaines peuvent avoir des incidences plus lourdes (hépatites A et E). Pour le moment, aucune réglementation n’impose la recherche des virus dans les plans de contrôle HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). À l’exception du règlement 2073/2005 qui prévoit qu’il conviendrait d’appliquer des critères pour les mollusques bivalves si une méthode de contrôle le permet, rien n’oblige les industriels à détecter les virus entériques. La médiatisation de la grippe H1N1 (non entérique) rappelle à tous les grandes capacités d’évolution de ces microorganismes. Il est peut-être temps de prendre ce risque en compte.
Prise de conscience
Le développement récent de tests de détection rapides de virus entériques marque aussi un tournant. « Une vingtaine d’entreprises agroalimentaires travaillent avec nous », annonce Fabienne Losy, directrice scientifique du Ceeram (Centre Européen d’Expertise et de Recherche sur les Agents Microbiens), laboratoire qui vient de lancer une gamme de kits dédiés à la détection de virus alimentaires. Cette jeune société, créée en 2005, propose aussi des prestations de R & D, d’expertise et de conseil / formation en virologie. « Des demandes de contrôle sur les produits alimentaires émergent dans certains pays voisins et nos clients préfèrent anticiper en intégrant dans leur plan HACCP des mesures de détection des virus. »
Depuis mars 2009, des experts travaillent pour le Codex Alimentarius à la description de précautions à prendre par le personnel et le traitement des aliments. « Outre l’élaboration d’un document général, trois groupes de discussion se concentrent spécifiquement sur les trois catégories d’aliments les plus concernés : les coquillages, les fruits rouges et les aliments prêts à consommer comme les sandwichs », précise Soizick Le Guyader, de l’Ifremer à Nantes. Les experts rappellent ainsi un ensemble de pratiques préventives connues comme le lavage des mains mais aussi des consignes spécifiques comme éviter d’implanter une station de coquillage à proximité d’une station d’épuration ou d’arroser des arbustes à fruits rouges avec de l’eau usée.
Ces recommandations du Codex s’adressent, bien sûr, à tous les pays, dont ceux en voie de développement. « Beaucoup des bonnes pratiques que nous préconisons sont usuelles. Cependant, nos travaux montrent que, par exemple, des fortes pluies engendrent des pics d’infections chez les consommateurs d’huîtres. » En France aussi, les débordements de stations d’épuration ne sont pas à exclure. « Suite à une contamination accidentelle, deux à trois mois de délais suffisent pour qu’un bassin ostréicole puisse à nouveau être exploité sans risque. »
Fort caractère infectieux
S’ils sont parfaitement concentrés dans le tube digestif de l’huître, les virus entériques n’y prolifèrent pas. Ils ne se multiplient que dans leur hôte cible, à savoir dans le cas des entériques humains, l’homme. Et « une seule particule virale suffit à déclencher une infection », rappelle Thierry Morin, chercheur à l’Adria (*) de Normandie. Second facteur aggravant, ces êtres très résistants se conservent très longtemps à l’état inerte. Ils résistent beaucoup mieux aux agents de nettoyage et aux traitements thermiques que les bactéries. Les norovirus et le virus de l’hépatite A, en particulier, ont même le pouvoir de supporter des conditions acides. « Les javels et l’acide peracétique sont les plus efficaces », mentionne Pierre Maris, chef de l’unité produits d’hygiène antimicrobiens de l’Afssa de Fougères. Ce laboratoire oriente, depuis 2000, ses recherches sur les virus et leur sensibilité aux biocides. L’intégration du risque viral en industrie est lourde de contrainte. Les doses des agents de désinfection doivent être nettement accrues par rapport à un objectif antibactérien. La longévité du matériel et les consommations en eau de rinçage en sont donc considérablement modifiées.
Détection normée
La prise en compte du risque virus pose aussi la question de la détection des virus dans les denrées alimentaires ou sur les surfaces. Le Groupe CEN Tag4 (pour la commission européenne) travaille à la définition d’une méthode normée de détection de norovirus et du virus de l’hépatite A. Cette mission, initiée il y a cinq ans, a abouti à un protocole reconnu par plusieurs experts et est désormais en attente de fonds pour sa validation auprès de plusieurs laboratoires.
La difficulté majeure des recherches en virologie est la mise en place de modèles. Il n’existe pas ou peu de solutions de culture à l’inverse des bactéries. « Leur développement sur culture cellulaire animale est souvent compliqué, voire impossible dans le cas de souches humaines de norovirus. On utilise donc des norovirus murins, très proches en termes de taxonomie pour les étudier », souligne Thierry Morin. Les modèles sont pourtant essentiels, car le second point délicat en virologie est la préparation et l’extraction des particules virales, d’autant qu’une seule suffit à infecter un individu. Enfin, les méthodes de détection font appel à la biologie moléculaire (PCR), plus précisément la RT-PCR en temps réel, car l’immunologie n’est pas adaptée. Le laboratoire Ceeram (Centre Européen d’Expertise et de Recherche sur les Agents Microbiens) a développé des kits d’analyses prêts à l’emploi, qui délivrent les résultats en 2 h 30.
Santé publique |