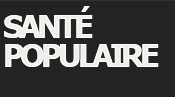Du recensement des savoirs au développement durable
Ethnopharmacologie
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
L’ethnopharmacologie est une discipline qui s’intéresse aux médecines traditionnelles et aux remèdes constituant les pharmacopées. Très schématiquement un programme d’ethnopharmacologie mis en œuvre dans une région particulière se déroule en trois temps : un travail de terrain, destiné à recenser les savoirs thérapeutiques, un travail en laboratoire visant à évaluer l’efficacité thérapeutique des remèdes traditionnels et un programme de développement de médicaments traditionnels préparés avec des plantes cultivées ou récoltées localement.
Les objectifs sont clairement énoncés et codifiés par des méthodologies rigoureuses : recenser partout dans le monde les savoirs traditionnels, notamment là où la tradition est orale, car la transmission de la connaissance est entravée à la fois par la perte d’intérêt pour le métier de guérisseur et par sa non-reconnaissance, voire son interdiction pour exercice illégal de la médecine.
Les trois actes de l’ethnopharmacologie
Sur le terrain : compréhension et inventaire
Comprendre le fonctionnement de la médecine traditionnelle, les principes qui la fondent, les influences culturelles qui l’ont façonnée, mais aussi les théories explicatives du monde visible et invisible, les conceptions de fonctionnement du corps et de l’esprit, de la physiologie, les causes des maladies et les principes de la thérapeutique : la compréhension du système thérapeutique traditionnel s’accompagne d’un essai de classification des métiers comme celui de tradipraticien, rebouteux, sage-femme, ou herboriste. On décrit enfin les itinéraires thérapeutiques, c’est-à-dire la façon dont les gens se soignent ou consultent, tantôt des représentants de la biomédecine, tantôt des thérapeutes traditionnels.
Faire l’inventaire des remèdes traditionnels en menant des enquêtes auprès des tradipraticiens afin de recenser leurs savoirs, mais aussi auprès de la population pour répertorier les usages populaires : les enquêtes précisent la composition du remède, son mode de préparation, ses rites d’usage, ses indications thérapeutiques, sa posologie, ses contre-indications et ses effets secondaires. Chaque information est accompagnée d’un échantillon de la plante (herbier) et de la drogue (droguier).
L’analyse des résultats pour la sélection des plantes à étudier repose sur la fréquence de citations, qui fait ressortir un fond commun reconnu par le groupe ou au contraire une information remarquable originale non partagée qui peut ouvrir vers la découverte d’une indication thérapeutique nouvelle. L’interprétation des données de terrain par une collaboration entre ethnologue et pharmacologue est souhaitable avant toute évaluation.
Au laboratoire : évaluation et indications thérapeutiques
Dans cette deuxième étape, on passe du terrain au laboratoire pour confirmer ou infirmer les indications thérapeutiques rapportées par le tradipraticien. On a recours à des outils modernes d’évaluation apportés par la pharmacologie dont le but est de mettre en évidence une action physiologique, en testant un extrait de plante sur des modèles animaux ou des cultures cellulaires. Si une plante est censée posséder une action contre l’inflammation, l’expérimentateur prépare un extrait de plante, conforme aux informations du tradipraticien, et vérifie son action anti-inflammatoire sur l’œdème de la patte de rat. Les méthodes utilisent les techniques de la pharmacologie in vivo ou in vitro sur molécule en prenant soin de vérifier la sensibilité, la spécificité et la reproductibilité pour des essais avec extraits complexes.
Par la suite, on recherche les substances actives de la plante par fractionnement bioguidé. Avec des solvants de polarité croissante, on réalise plusieurs extraits issus de la même plante sur lesquels on piste l’activité physiologique.
Des essais de toxicité sont réalisés afin de garantir l’innocuité et l’absence d’effets cancérogènes ou mutagènes qui ne sont en général pas décelés par la tradition, les effets délétères se manifestant plusieurs années après l’ingestion. Cette étape est implicitement réductionniste, la plante étant prise comme source de
molécules actives, déconnectée des aspects rituels.Le retour vers le terrain : pour un accès aux soins et un développement durable
Le retour vers le terrain s’impose de fait par deux constatations majeures :
- les connaissances recensées auprès des gens ont été obtenues généreusement par l’instauration d’une confiance entre l’enquêteur et l’informateur. Elles doivent être restituées au pays sous forme de publications scientifiques accessibles à tous ;
- le simple bon sens : l’accessibilité aux médicaments est difficile dans la plupart des pays du Sud en raison de déficience ou de coût. Or, on dispose de plantes médicinales d’usage traditionnel et de travaux de pharmacologie et toxicologie montrant leur efficacité et leur innocuité. Développer des médicaments à base de plantes locales issues des traditions est une réponse adaptée au développement de la santé pour tous.
L’ethnopharmacologie est ainsi une discipline incontournable allant dans le sens de l’histoire : conserver et entretenir son patrimoine culturel, le savoir sur les plantes, évaluer l’intérêt thérapeutique des remèdes traditionnels en laboratoire, valoriser les ressources naturelles dans les perspectives du développement durable. Mais cette simplicité n’est qu’apparente car toutes les étapes exigent des méthodes de travail rigoureuses et parfaitement codifiées.
C’est au cours du 1er Congrès européen d’ethnopharmacologie de Metz, en 1990, qu’a été proposée une nouvelle définition de l’ethnopharmacologie, comme étant « l’étude scientifique interdisciplinaire de l’ensemble des matières d’origine végétale, animale ou minérale et des savoirs ou des pratiques s’y rattachant, que les cultures vernaculaires mettent en œuvre pour modifier les états des organismes vivants à des fins thérapeutiques, curatives, préventives ou diagnostiques ».
L’ethnopharmacologie a bâti son émancipation par la mise en place de méthodologies qui se sont affinées au fil des ans. Elle trouve son originalité et sa force dans sa pluridisciplinarité, recherchant systématiquement la collaboration de spécialistes des sciences de l’homme (anthropologues, historiens, linguistes, juristes) et des sciences de la nature (botanistes, pharmacologues, toxicologues, chimistes, cliniciens et agronomes).
Quand les disciplines dialoguent dans un creuset fécond
L’ethnologie est une approche scientifique desciétés et de leur culture, décrivant notammentconceptions vernaculaires de la santé, de la malet des remèdes. La pharmacologie est une approche scientifique expérimentale cherchant à démontrer et expliquer les effets des substances médicamenteuses, naturelles ou de synthèse chimique ou biologique, sur des êtres vivants.
La chimie végétale, via l’identification des molécules responsables de l’activité ou des marqueurs, est le prolongement naturel de l’ évaluation pharmacologique permettant de comprendre le mécanisme d’action.
La botanique, avec une identification précise, est la pierre angulaire de l’étude des plantes.
Depuis deux mille ans, l’homme a nommé les plantes, avec des systèmes de classifications spécifiques dans plus de cinq mille langues ou dialectes qui n’ont de sens que dans les régions de culture et de langue communes. Une classification reconnue de tous a été élaborée par le botaniste suédois Linné, qui a dénommé chaque plante par deux noms seulement : le genre et l’espèce.
L’histoire est le témoin du cheminement de la connaissance au travers des civilisations. Les historiens des sciences permettent de retracer le cheminement de la connaissance au travers des différentes civilisations, en particulier grâce aux ouvrages de référence des quatre grandes médecines savantes de tradition écrite : les médecines grecque, indienne, chinoise et arabo-persane. On détermine pour chaque plate médicinale recueillie si elle constitue un apport original récent ou si elle s’inscrit dans un usage d’une longue tradition écrite. Enfin, le droit, l’agronomie et la pharmacie galénique sont les outils du développement. Le développement de médicaments à base de plantes est encadré par une pharmacopée nationale (Europe, États-Unis, Chine) et une réglementation qui garantissent l’identité, la qualité et la traçabilité. Or, dans la plupart des pays du Sud, l’élaboration des pharmacopées nationales reste à faire. Proposer l’usage de plantes médicinales ou la fabrication de phytomédicaments implique de les cultiver grâce à la compétence des agronomes.
Le savoir-faire du pharmacien est indispensable pour préparer des médicaments dans une forme galénique facile à mettre en œuvre dans les pays du Sud, ne nécessitant pas de technologie trop sophistiquée, comme les poudres, sirops, pommades, ou extraits fluides ou secs en gélules.
L’utilité de l’ethnopharmacologie
Si l’ethnopharmacologie puise son ancrage dans les traditions du passé, ses perspectives s’ouvrent résolument vers l’avenir.
Pour un conservatoire des savoirs et des espèces végétales
Face au rythme actuel de la déforestation, des mesures conservatoires sont prises en faveur de la sauvegarde des espèces. Or la préservation des plantes serait-elle vraiment efficace sans être associée à la sauvegarde des savoirs traditionnels ? La restitution écrite des savoirs oraux favorise de plus la formation des générations à venir.
Les plantes ont de tout temps voyagé d’une civilisation à l’autre, puis été intégrées dans les pharmacopées. La médecine arabo-persane est l’héritière à la fois de la médecine hippocratique et de la médecine ayurvédique de l’Inde. La médecine traditionnelle chinoise a, depuis des siècles, intégré dans son système de pensée médical des plantes de la médecine arabo-persane, comme le fenugrec, l’aloès ou l’encens, et plus de 300 plantes européennes comme la belladone, le fenouil ou la bardane. Certaines plantes chinoises ont été intégrées à la pharmacopée européenne, comme le ginseng, la réglisse ou la badiane. Aujourd’hui, les Occidentaux s’intéressent un peu tardivement aux plantes chinoises, pour les évaluer, avec les critères pharmacologiques et cliniques propres au système médical occidental, dans l’espoir de découvrir de nouveaux médicaments. Les Européens ont aussi intégré dans leur pharmacopée des plantes issues de traditions orales africaines (kola) et amérindiennes (quinquina).
Pour une phytothérapie efficace moins iatrogène dans les pays du Nord
Les résultats obtenus de l’évaluation, combinant pharmacologie et identification chimique, sont étonnants car dans 75 % des cas, ils confirment l’indication thérapeutique recueillie, montrant la pertinence des savoirs traditionnels. Les plantes se classent dans deux catégories, celles dont les molécules isolées sont actives et celles dont les extraits ont une activité supérieure :
Les plantes à principe actif isolé ont donné à l’industrie pharmaceutique ses lettres de noblesse, faisant progresser l’espérance de vie. Citons simplement les médicaments analgésiques, comme la morphine et la codéine extraites du pavot à opium, ou les alcaloïdes anticancéreux extraits de la pervenche de Madagascar. Certaines de ces plantes sont toxiques, mais à doses maîtrisées un toxique est un bon médicament potentiel, comme la digitaline cardiotonique extraite de la digitale cardiotoxique ;
les plantes à extraits standardisés sont souvent dépourvues de toxicité, plusieurs molécules chimiques sont identifiées, mais aucune d’entre elles n’est capable de reproduire la même efficacité que l’extrait de départ. C’est le cas de l’eschscholzia, la valériane, la passiflore, l’harpagophytum ou certaines plantes antimalariques, dans lesquelles les molécules identifiées possèdent une légère activité, toujours inférieure à celle de l’extrait. Il y a en fait synergie entre différents principes, renforçant la biodisponibilité ou l’efficacité, et rendant l’extrait complexe supérieur à la somme des parties. C’est une stratégie intéressante qui mériterait d’être mieux étudiée, car il y a un paradoxe dans la recherche, quand on développe des trithérapies antibiotiques pour lutter contre les bactéries résistantes ou antivirales comme le VIH, en même temps qu’on déconsidère les extraits de plantes standardisés aux principes actifs associés.
Les médicaments à base de plantes apportent pourtant des réponses thérapeutiques dans des indications diverses, avec des effets secondaires moindres. On peut citer l’exemple de l’anxiété ou de l’insomnie avec l’eschscholzia, la passiflore ou la valériane prises en alternance avec les anxiolytiques ou les somnifères de synthèse dont certains ont des effets secondaires amnésiants à long terme, ou encore celui des douleurs inflammatoires avec l’harpagophytum, la feuille du cassissier ou le saule en alternative ou complément des anti-inflammatoires dont les effets secondaires ulcérogènes sont bien connus.
Les médecines traditionnelles chinoise et ayurvédique, enseignées dans des universités, pratiquées dans des hôpitaux, dispensées sous forme de médicaments complexes, attestent là encore de l’intérêt des extraits ou des systèmes complexes.
Pour des médicaments à base de plantes locales pour les pays du Sud
L’accessibilité aux soins dans les pays du Sud avance peu avec le temps. Certes, des progrès sont réalisés chaque année, mais depuis trente ans, selon l’OMS, 80 % de la population se soigne grâce à la médecine traditionnelle car les soins modernes sont coûteux ou indisponibles. D’où l’idée formulée par l’OMS, en 1978, lors de la convention d’Alma Ata, que les pays doivent évaluer leurs pratiques traditionnelles et les intégrer dans les systèmes officiels de santé. C’est en quelque sorte de l’ethnopharmacologie appliquée.
Deux actions prioritaires se dégagent de ces enjeux :
- une action d’urgence auprès des populations rurales, d’abord en initiant des formateurs à la reconnaissance de plantes médicinales dûment sélectionnées à partir des savoirs traditionnels et d’une évaluation attestant innocuité et efficacité, puis en développant des jardins de plantes médicinales et des pharmacies communautaires afin de préparer des phytomédicaments dans des formes galéniques simples (sirops, pommades, poudres, extraits, teintures), en particulier contre les maladies parasitaires ;
- une action au niveau des États, en apportant une expertise pour la mise en place d’une pharmacopée nationale avec des monographies de plantes médicinales permettant le contrôle de la qualité de la matière première, les garanties sur l’innocuité et une meilleure opportunité pour le développement industriel de médicaments à base de plantes contrôlées.
Pour une santé et un développement durables avec une charte éthique
Développer des médicaments à base de plantes requiert le respect des conventions de Washington et de Rio. Une étude entreprise par le WWF au niveau européen montre que des espèces sauvages européennes (busserole, arnica, gentiane), asiatiques (réglisse) ou africaines (hargophytum) sont menacées par des récoltes excessives. Aujourd’hui, Rhodolia crenulata, une plante de l’Himalaya, risque de disparaître car ses rhizomes sont récoltés intensivement pour en faire des compléments alimentaires proposés sur plus de 900 sites Internet. Face à ces menaces, la Convention de Washington répertorie les espèces menacées d’ extinction (CITES, annexe 1302 plantes) pour lesquelles le commerce est autorisé exceptionnellement.
Une autre question est celle de la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels. Si l’usage traditionnel d’une plante est connu et a déjà fait l’objet d’une publication, aucun brevet revendiquant les propriétés de cette plante ne peut être déposé. La Convention de Rio sur la diversité biologique stipule que les ressources naturelles d’un pays ne peuvent être exploitées par un organisme public ou privé d’un autre pays sans accord préalable précisant les droits d’exploitation et le partage des retombées économiques.
Ainsi formalisée en trois étapes, terrain (le recensement des savoirs), laboratoire (l’évaluation) et retour au terrain (les projets de développement durable), l’ ethnopharmacologie apparaît comme un programme logique et rigoureux pour proposer un accès aux soins avec des médicaments à base de plantes produits dans leur terroir et issus des savoirs locaux.
Ethnopharmacologie |