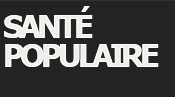Le commerce équitable
Entreprises & Marchés
- Interaction médicament-récepteur
- Tabagisme
- Cosmétologie
- Dossier
- Société
- Environnement
- Santé
- Portrait
- Technologie alimentaire et nutrition
- Système sympathique
- Consommation
- Bioentreprise
- Page professionnelle
- Ethnopharmacologie
- Technologie
- Effets secondaires
- Sida
- Nutrition
- Innovation
- Entreprise
- En bref...
- Industrie agroalimentair
Une notoriété croissante
Mais sur des marchés où les intermédiaires sont nombreux et où le lien entre l’entreprise et les petits producteurs n’est pas direct (c’est le cas du café), le commerce équitable est la réponse la plus appropriée. Si sa notoriété croît d’année en année, pour atteindre aujourd’hui plus de 30 % (contre 10 % seulement en 2000), la compréhension de son fonctionnement et de ses objectifs restent flous pour nombre de consommateurs. Sa définition est a priori simple : payer un prix juste aux producteurs les plus défavorisés (le plus souvent du Sud) et leur assurer un niveau de vie et de développement décent, via des relations durables. Dans l’application, les choses se compliquent.
Car pour créer une « filière » de commerce équitable, il faut établir et faire respecter un ensemble de règles aux acteurs impliqués, du producteur au consommateur.
Max Havelaar, pionnier en GMS
Si la filière dite intégrée, faisant intervenir des magasins et des importateurs spécialisés, est la forme associative historique du commerce équitable, elle a été avec le temps dépassée par la filière labellisée (50 à 60 % du CA total). L’objectif de cette dernière est de permettre à un industriel, sans savoir-faire en la matière, de respecter les engagements du commerce équitable sur tout ou partie de sa production.
Et c’est là qu’intervient l’association Max Havelaar. Son fameux « label » offre une garantie aux consommateurs que le produit qu’il achète est bien « équitable » et que des règles ont bien été respectées. Lesdites règles sont définies par FLO (Fairtrade Labelling Organization), l’organisation internationale de la filière labellisée, qui a également la charge de les faire appliquer : fonctionnement démocratique des coopératives, transparence de gestion, etc. Mais le respect de ce cahier des charges privé, dont dépend la certification des agriculteurs, implique des contrôles réguliers sur le terrain, dans les pays concernés. Du sérieux de ces procédures, clés de voûte de l’association, dépendent toute la crédibilité du label. Ils représentent un coût, financé par les entreprises concessionnaires via une redevance versée à Max Havelaar. En échange de l’exploitation du label, elles s’engagent à adopter des modalités commerciales spécifiques dont la fixation du prix d’achat. En 2002, 220 références portaient le label Max Havelaar (dont 95 pour le café et 100 pour le thé), réparties entre une trentaine de marques nationales et de distributeurs concessionnaires et huit produits (café, thé, chocolat, riz, banane, sucre, miel et jus d’orange). Méo, Malongo et Lobodis pour le café, Teching et Equithé pour le thé, Elite pour le chocolat, etc., comptent parmi les plus connues. Côté distribution, le nombre de référencements varient d’une enseigne à l’autre, avec une longueur d’avance pour Monoprix et Cora, le café équitable étant de loin le plus représenté en GMS. Autre entreprise concessionnaire, Alter Eco (voir encadré), spécialisée dans l’importation et la distribution, a développé une offre de produits labellisés Max Havelaar, destinés à la grande distribution. Avec une charte graphique homogène, sa gamme, étoffée, bénéficie d’une bonne visibilité d’un rayon à l’autre.
Quand le bio se marie à l’équitable
Mais tous les acteurs économiques ne sont pas prêts à payer pour devenir concessionnaires. Certains reprochent en effet à Max Havelaar et FLO leur situation monopolistique et le manque d’indépendance des fonctions de certification et de contrôle. Ainsi sur le « marché » du commerce équitable, d’autres initiatives voient le jour. Comme l’organisme de contrôle et de certification,
Ecocert, spécialisé dans le bio et agréé par les pouvoirs publics, qui a développé pour certains industriels, dont Cémoi, le label Bioéquitable sur une filière cacao. D’autres filières sont en développement. La différence avec max Havelaar ? La démarche s’adresse aussi bien aux producteurs du Nord que du Sud. « Le produit est à la fois bio et équitable, et les contrôles et la certification sont confiés à un organisme de certification indépendant et accrédité », ajoute Philippe Blais, responsable qualité client chez Ecocert. Si les standards définis par FLO ne sont pas suivis à la lettre, le fonctionnement de la filière n’en est pas moins sérieux et est sensé donner toute sa crédibilité à la démarche. L’émergence d’une forme de concurrence sur une cause humanitaire ? Et pourquoi pas...
Une position différente selon les enseignes
Mais l’alliance du bio et du commerce équitable n’est pas fortuite. Comme tend à le montrer une étude réalisée par Alter Eco, le taux de notoriété du label AB est en effet très élevé parmi les acheteurs du commerce équitable. Une logique que les distributeurs, comme les industriels, ont bien comprise, en particulier sur le café, le thé et le chocolat. Ainsi, certaines marques mettent en avant à la fois le label AB et le logo Max Havelaar. À l’image de monoprix Bio et Casino Bio, et des marques Equithé et Lobodis.
Si l’ensemble des distributeurs intègre les produits Max Havelaar dans leurs linéaires, tous ne développent pas des MDD portant le label reconnu. C’est le cas de Carrefour, Système U et Intermarché. Le premier voit d’un mauvais œil la suprématie de FLO et le fait de devoir payer une redevance pour prétendre faire du commerce équitable. Car en matière de développement durable, l’enseigne sait communiquer, au même titre que ces congénères, qui incluent le commerce équitable dans une démarche plus globale de développement durable. Mais paradoxalement, la notoriété du commerce équitable fait aussi sa faiblesse. En effet la crainte de FLO, Max Havelaar et autres organisations, est de voir se multiplier les filières parallèles. À l’instar de Sainsburry en Grande Bretagne qui a développé sa propre marque de café équitable en appliquant les mêmes règles et en s’approvisionnant aux mêmes sources, sans avoir à payer de redevance. Tout en bénéficiant de la notoriété du label. On peut comprendre les risques de telles initiatives. Car à vouloir parier sur la grande distribution pour se développer, le commerce équitable s’expose à une récupération marketing. Pour défendre sa cause, reste la communication. Un défi que l’ensemble des acteurs doit relever pour sensibiliser et convaincre les consommateurs. Car au final, ce sont bien eux qui acceptent de payer plus cher, pour assurer une meilleure redistribution des marges et verser un prix juste aux producteurs du sud. Et au Nord ? On devine à l’avance l’avis des éleveurs de porc français sur la question...
Entreprises & marchés |