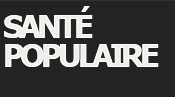-
Le traitement de l'état de stress post-traumatique
-
L'état de stress post-traumatique (ÉSPT) est un trouble mental commun chez les personnes qui ont été exposées à des évènements traumatiques. Depuis son introduction au sein des systèmes de classification en psychiatrie dans les années 1980, diverses approches psychothérapeutiques ont été mises à l'essai dans le traitement de l'ÉSPT. L'efficacité de ces thérapies dans la réduction des symptômes de stress post-traumatique varie considérablement de l'une à l'autre. Des méta-analyses d'essais cliniques contrôlés à répartition aléatoire ont permis de conclure que les psychothérapies se concentrant sur le traumatisme sont les plus efficaces dans le traitement de l'ÉSPT (Bisson et coll. 2007; Bradley et coll. 2005; Van Etten et Taylor 1998). Les thérapies axées sur les traumatismes comprennent des approches de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), particulièrement la thérapie par l'exposition et la thérapie cognitive, ainsi que l' intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing ou EMDR ). Une analyse de ces thérapies, de leur fondement théorique, de leurs applications, de leur efficacité et des enjeux entourant leur possibilité d'exécution dans différents contextes est exposée dans le présent article.
-
Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDA/H)
-
À l'échelle globale, beaucoup de recherches comparatives et d'analyses sur le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ont été effectuées. Accompagnant celles-ci, beaucoup de discussions et polémiques ont également été créées sur le sujet, particulièrement quant à l'étiologie et l'utilisation de méthodes d'intervention appliquées dans le traitement du TDAH (Pena, J.A., Montiel Nava C. 2003).
-
Le trouble de la personnalité limite
-
Le trouble de la personnalité limite (TPL) est une affection psychiatrique grave et courante caractérisée par une instabilité émotionnelle, une impulsivité marquée et d'importantes déficiences dans la capacité de travailler et d'entretenir des relations significatives. Les patients atteints du TPL luttent contre une peur irraisonnée de l'abandon, des perturbations identitaires et un mode de pensée persécutoire. Elles sont susceptibles d'avoir des tendances suicidaires, des comportements autodestructeurs répétés, accompagnés de troubles de l'humeur, d'anxiété et de toxicomanie. Stern (1938) est l'auteur du terme « personnalité limite » décrivant les patients psychiatriques déficients et difficiles à traiter dont les symptômes se situent quelque part entre la névrose et la psychose. Les personnalités limites constituaient donc « une catégorie plus vaste de patients dont la psychologie ne reflétait pas le chaos, la déviance ou la déficience habituellement associée aux patients psychotiques au cours des épreuves de réalité, et qui n'avaient pas la capacité d'intégration, la stabilité relationnelle et le contrôle des pulsions affectives habituellement associés aux patients névrosés » (Kernberg and Michels 2009). Le trouble de la personnalité limite demeure l'un des problèmes de santé mentale les plus graves de tout le domaine de la psychiatrie.
-
Troubles du langage chez l'enfant
-
On désigne les enfants présentant des troubles du langage selon différents termes, comme enfants ayant un trouble du langage, enfants ayant un déficit du langage, enfants ayant un retard de langage ou ayant des troubles spécifiques du langage. Les cliniciens ont tendance à utiliser les trois premiers termes, alors que le trouble spécifique du langage est le terme qui est privilégié dans les publications de recherche. Un trouble du langage se définit comme un retard significatif dans l'utilisation et/ou la compréhension du langage verbal ou du langage écrit. Il peut s'agir d'un trouble sur le plan de la forme du langage (phonologie, syntaxe et morphologie), un trouble de fond ou de sens (sémantique) ou un trouble lié à son utilisation (pragmatique) ou une combinaison de ceux-ci (American Speech-Language-Hearing Association 1993). La phonologie est un aspect du langage s'intéressant aux règles régissant la structure, la répartition et le séquençage des phonèmes. La syntaxe est le système de règles grammaticales régissant la manière dont les mots sont combinés pour former de plus grandes unités signifiantes, comme les locutions, les propositions et les phrases. La morphologie est l'aspect du langage régissant la structure des mots et comprenant les inflexions grammaticales porteuses du temps des verbes. La sémantique est l'aspect du langage régissant la signification des mots et des combinaisons de mots. La pragmatique s'intéresse quant à elle à l'aspect social de l'utilisation du langage. Les difficultés langagières éprouvées par la personne doivent survenir dans sa langue maternelle afin que celles-ci soient considérées comme des troubles du langage.
-
Les troubles du sommeil chez les patients en réadaptation
-
Les perturbations du sommeil chez les patients en réadaptation n'ont pas encore fait l'objet de beaucoup d'attention. Des études émergent seulement pour documenter les différents types de troubles du sommeil dans le contexte de blessures induites ou de problèmes de santé de nature progressive. Une variété de facteurs physiologiques, psychologiques et environnementaux peut influencer les habitudes de sommeil, ainsi que l'organisation et la qualité du sommeil des individus en cours de réadaptation. Bien que les problèmes du sommeil soient souvent perçus comme des problèmes secondaires ou des problèmes que l'on espère résoudre de manière spontanée grâce au rétablissement des autres problèmes, il devient de plus en plus évident que les troubles du sommeil peuvent ralentir le processus de réadaptation et influencer l'ensemble des résultats d'un patient. Par exemple, il a été démontré que la présence de perturbations dans le cycle veille-sommeil est liée aux séjours prolongés à l'établissement hospitalier ou à un centre de réadaptation (Makley et coll. 2008). Étant donné les efforts et les coûts liés à la réadaptation, il est impératif de considérer les troubles du sommeil comme des facteurs dissuasifs du processus entier et d'allouer une attention et des ressources scientifiques et cliniques adéquates au domaine.