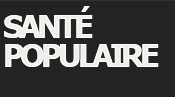-
En finir avec
la douleur
-
« La douleur n’est pas une
fatalité ! », affirmait-on, lors
de la campagne antidouleur, en
1998. Certes, depuis quelques
années, elle est mieux prise en
charge, et de nombreuses
équipes de recherche tentent
d’en améliorer les traitements.
Mais sommes-nous arrivés au
bout du tunnel ?
-
Virus entériques
Une préoccupation émergente
-
La virologie est, sans conteste, le parent pauvre de la
recherche en microbiologie alimentaire. Très peu enseignée, cette discipline s’adresse, pour l’essentiel, au domaine médical. Pourtant, le mode de transmission fécoorale des virus entériques implique aussi l’alimentation,
même si l’eau et les contacts interhumains en sont les
principaux vecteurs. Les problèmes intestinaux que
nous connaissons tous un jour ou l’autre ne sont pas à
négliger. Les toxi-infections alimentaires d’origine
virale n’engendrent, pour la plupart des cas, que des
troubles mineurs (diarrhée), mais certaines peuvent
avoir des incidences plus lourdes (hépatites A et E).
Pour le moment, aucune réglementation n’impose la
recherche des virus dans les plans de contrôle HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point). À
l’exception du règlement 2073/2005 qui prévoit qu’il
conviendrait d’appliquer des critères pour les
mollusques bivalves si une méthode de contrôle le
permet, rien n’oblige les industriels à détecter les virus
entériques. La médiatisation de la grippe H1N1 (non
entérique) rappelle à tous les grandes capacités
d’évolution de ces microorganismes. Il est peut-être
temps de prendre ce risque en compte.
-
Diabète
L’état
d’urgence
-
Toutes les dix secondes dans le monde, un individu
meurt des complications du diabète et deux nouveaux
cas sont diagnostiqués. En vingt ans, le nombre de
malades a explosé, passant de 35 millions en 1985 à
plus de 250 millions aujourd’hui, hissant cette affection
due à une trop forte présence de sucre dans le sang à la
quatrième cause de mortalité dans les pays développés.
Et les perspectives font froid dans le dos : près de 435
millions de malades en
2030, dont 80 % dans les
pays en voie de développement. Une
situation d’
autant plus alarmante que
cette inflation va s’accompagner d’une
hausse du nombre des
complications graves
inhérentes à la maladie :
accidents cardiovasculaires, cécité, amputations, insuffisance rénale...
Le diabète représente déjà la
cause de cécité
dans les pays développés.
-
Un gène identifié
pour la migraine
-
La migraine est le plus commun des troubles neurologiques et la cause la plus fréquente des maux de tête épisodiques. La migraine affecte
environ 15 % de la population, soit environ 41 millions d’européens. Son coût pour la collectivité est estimé à 27 milliards d’euros par an,
en Europe. Bien que la composante génétique des migraines soit bien établie, notamment par des études sur des jumeaux et des familles, aucun gène n’avait pu être relié à la sensibilité à la migraine en raison de la variabilité des symptômes. Ceux-ci vont de douleurs dans
les tempes, qui se manifestent souvent d’un seul côté, à une sensibilité aiguë au bruit et à la lumière. Ils peuvent être accompagnés de
troubles gastro-intestinaux de type nausées et vomissements.